Couplée à des capacités accrues de traitement statistique, la disponibilité via le big data de données de masse sur les individus, leurs pathologies et leurs expositions va sans doute entraîner des progrès importants dans la détection des maladies professionnelles, voire dans leur prédiction à court terme. Mais les capacités d'observation en temps réel et de prédiction à court terme que promettent les avancées scientifiques actuelles ne dédouanent pas de réflexions plus globales et à plus long terme sur les risques professionnels. Cela est d'autant plus important que le monde du travail connaît aujourd'hui des transformations d'ampleur qui remettent en cause l'organisation du système de prévention.
Sans vouloir lister ici l'ensemble de ces transformations, citons néanmoins le brouillage de certaines frontières qui séparent travail salarié et indépendant, temps de travail et personnel, outil professionnel et de loisir, travailleurs humains et machines, réglementations nationales et européennes ou internationales... On ne peut certes prédire les différentes formes que prendra le travail dans les années qui viennent, mais imaginer ses configurations possibles pour demain semble un exercice indispensable pour concevoir les grands axes de politiques de prévention qui devront nécessairement s'affranchir en partie des cadres dans lesquels elles sont pensées aujourd'hui. Si les politiques et outils de prévention ne peuvent évoluer constamment au gré de la conjoncture, ils ne peuvent pas non plus ne pas tenir compte des grandes évolutions qui les chahutent.
Identifier les futurs possibles
Le défi est donc de conduire des réflexions sur le futur à moyen et long terme qui puissent être utiles à l'élaboration de politiques ou de stratégies intégrant la dimension du temps long et l'incertitude qui y est intrinsèquement liée. C'est le sens des démarches prospectives que de tenter de répondre à cette exigence.
Les démarches prospectives ne prétendent pas en effet prédire l'avenir, mais sont généralement développées dans des situations d'incertitude où il convient de se préparer à une diversité de futurs possibles. Elles consistent globalement à identifier les principales variables qui peuvent avoir un impact sur le sujet traité, à estimer leurs développements à venir, y compris en émettant des hypothèses, à s'interroger sur les interactions entre les différentes évolutions étudiées, parfois sous la forme de scénarios. Démarche de réflexion sur l'avenir, la prospective peut contribuer à réduire certaines incertitudes par le raisonnement, mais contribue aussi souvent à susciter de nouvelles interrogations.
Les méthodes prospectives ont été développées pour construire des anticipations rationnelles sur des sujets complexes qui ne sont pas prévisibles à l'aide d'extrapolations ou de modèles prévisionnistes. Elles semblent donc particulièrement bien adaptées aux risques professionnels. En effet, au-delà des causes immédiates et "facilement" identifiables des accidents du travail et maladies professionnelles (chutes, inhalation de produits toxiques, etc.), les causes indirectes ont aussi une grande importance. Par exemple, si le BTP reste un secteur très "accidentogène" malgré des risques mécaniques et chimiques relativement bien connus et des innovations techniques qui auraient dû conduire à les réduire, c'est que de nombreux facteurs extérieurs viennent perturber la mise en place de mesures de prévention.
Aussi l'anticipation des risques professionnels doit-elle prendre en compte un grand nombre de variables qui ne sont pas directement causes de risques, mais contribuent à façonner des situations à risque, telles que les systèmes de management, le développement de l'automatisation, l'apparition de nouvelles contraintes liées notamment à la préservation de l'environnement, à l'organisation du travail et de la sous-traitance, y compris au niveau international, etc. Ces variables ne sont pas nouvelles, mais leur interdépendance s'accroît et leurs évolutions semblent de plus en plus rapides.
La rapidité de ces évolutions, loin de décourager toute tentative d'anticipation, devrait stimuler des réflexions prospectives de long terme qui soient susceptibles de décrypter les grandes logiques présidant aux changements et, ainsi, de suggérer des grilles de lecture des phénomènes en cours. Gaston Berger, l'un des pères fondateurs de la prospective française, proposait cette métaphore
: "Sur une route bien connue, le conducteur d'une charrette qui se déplace au pas, la nuit, n'a besoin pour éclairer sa route que d'une mauvaise lanterne. Par contre, l'automobile qui parcourt à vive allure une région inconnue doit être munie de phares puissants. Rouler vite sans rien voir serait proprement une folie."
La prospective des risques professionnels suppose donc de ne pas se limiter à la simple observation des réalités, mais de saisir quelles sont les principales forces motrices des évolutions, leurs interactions, d'envisager les ruptures potentielles pour dessiner le paysage des futurs possibles.
Un guide pour l'action
Cette réflexion prospective, les variables concernées, la carte des futurs possibles ne seront pas les mêmes selon que la démarche est menée dans une entreprise, au sein d'une branche ou encore à l'échelle globale d'un pays, voire d'un continent (démarches européennes, par exemple). Les analyses des transformations générales de la démographie des métiers seront ainsi utiles au niveau global, pour la direction générale du Travail ou la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), afin d'anticiper à leur juste mesure les risques émergents présents dans certains secteurs en forte croissance, comme l'aide à la personne. Ces données seront en revanche de peu d'utilité à l'échelle d'une entreprise.
Le dimensionnement des démarches de prospective dépend aussi largement des acteurs qui les entreprennent, et donc des leviers dont ils disposent. Car ces démarches n'ont pas pour vocation de construire un savoir académique sur les risques de demain, mais de nourrir les politiques de prévention, donc de conduire à des décisions et à la mise en place de mesures concrètes. Les acteurs concernés doivent ainsi pouvoir s'approprier les réflexions, les résultats de ces démarches. C'est une des clés du succès.
Il appartient ainsi aux organismes en charge de la prévention des risques professionnels de développer aux échelles appropriées des analyses prospectives utiles pour bâtir les grands cadres d'évaluation, de recommandation ou de réglementation qui seront nécessaires à la prise en charge des risques identifiés. Ces organismes peuvent aussi s'appuyer sur ces analyses pour proposer des politiques visant à renforcer leurs missions, périmètres d'action et modes de fonctionnement. Mais il ne s'agit plus là de prospective, plutôt de capacité de conviction et de courage.
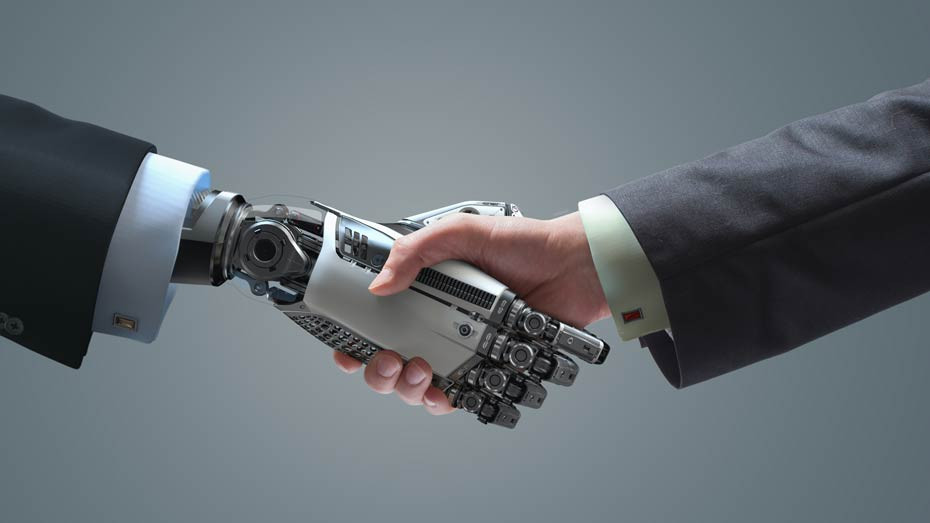 © Shutterstock
© Shutterstock