C'est une vieille histoire. Pratiquement depuis que la statistique existe, elle s'est mêlée de santé, de travail, voire des liens entre les deux. C'est particulièrement vrai en France. L'hygiéniste Louis René Villermé, considéré comme un des pionniers de la médecine du travail, fut aussi l'un des fondateurs de la Société de statistique de Paris en 1860. En 1893, un autre médecin, Jacques Bertillon, fit adopter par l'Institut international de statistique, à Chicago, deux projets de classification, des professions d'une part, des maladies d'autre part ; il désignait la profession comme facteur de risque et plaidait pour que des études de mortalité relient les métiers et les causes de décès. A la fin du XIXe siècle, après la création de l'Inspection du travail, plusieurs séries statistiques sur le travail furent constituées. Elles jouèrent un rôle important pour légitimer la création d'un ministère du Travail en 1906. Entre-temps, la loi de 1898 sur l'indemnisation des accidents du travail avait fondé la notion de risque professionnel sur une base statistique.
Le tournant des années 1970
Certaines caractéristiques du dispositif français de statistiques sur le travail et ses conséquences sanitaires sont donc apparues très tôt : les chiffres sont chargés de pousser au débat social, de susciter une demande politique, avant d'y répondre en partie. Pourtant, pendant plusieurs décennies, l'étude statistique du travail va se centrer sur l'usage routinier de quelques chiffres sur la durée du travail, les accidents, puis les maladies professionnelles reconnues. De ce point de vue, le début des années 1970 a constitué un tournant original. Dans cette période qui suivait les événements de mai-juin 1968, l'intérêt pour l'activité de travail et les conditions de travail a été porté aussi bien par des réseaux de syndicalistes marqués par les conflits récents que par une mouvance " sociale " au sein du patronat et par certains responsables gouvernementaux. C'est l'époque où naquit l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact), l'époque où se déroula la plus grande négociation interprofessionnelle sur les conditions de travail en France, avec un accord-cadre en 1975. Il était logique alors de stimuler la création de statistiques nouvelles.
Amorcé vers la fin des années 1970, le " système " d'enquêtes sur les conditions de travail et la santé au travail est arrivé un peu tard au regard de l'effervescence des années précédentes. La crise de l'emploi s'était installée. Le gouvernement et les partenaires sociaux avaient d'autres priorités. Les enquêtes ont néanmoins disposé de ressources, en termes de crédits et de temps (celui des médecins du travail, surtout). Elles ont vécu leur vie et se sont développées : enquêtes nationales sur les conditions de travail, menées tous les sept ans depuis 1978 par des enquêteurs de l'Insee au domicile des salariés ; avec une cadence analogue depuis 1987, enquêtes Sumer sur les risques professionnels, réalisées par des centaines de médecins du travail ; apparition de questions sur le travail dans les grandes enquêtes portant sur la santé ou sur les conditions de vie ; plus récemment, enquête Santé et itinéraire professionnel (SIP), avec une interrogation des mêmes personnes à deux dates (2006, 2010). Parallèlement, de nombreux autres outils ont été créés, dont l'initiative n'est pas venue des pouvoirs publics, mais de réseaux d'épidémiologistes ou de médecins : la cohorte Gazel à EDF-GDF (née en 1989), le suivi des troubles musculo-squelettiques en région Pays-de-la-Loire (2002-2005), l'enquête Samotrace sur la santé mentale (2006-2007), ou encore les enquêtes Estev (1990-1995) et SVP50 (2003) sur le vieillissement au travail.
Belle moisson de données, sans aucun doute, et belles perspectives si l'on retient que plusieurs de ces dispositifs sont encore exploités, seront réédités ou seront rejoints par des outils nouveaux, comme l'enquête nationale en préparation sur les facteurs de risque psychosociaux au travail. Dans l'ensemble, les buts visés sont atteints, à commencer par le premier, évoqué plus haut : secouer les consciences, faire reculer les attitudes d'indifférence et la croyance toute faite en un supposé progrès " naturel " des conditions de travail, donc conforter la nécessité de politiques publiques et de négociations sociales actives. Au-delà, un autre résultat important est de répondre à un souci de détail, de précision : les constats ne sont pas uniformes ; qu'il y ait des progrès dans tel domaine, tel secteur ou telle population, voire tel pays, et pas dans tels autres, sert à désigner des priorités d'action dans les situations " les pires " et à montrer qu'il n'y a pas de fatalité puisque d'autres situations sont " meilleures ". Enfin, grâce à la participation de chercheurs de disciplines diverses et de praticiens dans l'élaboration et l'utilisation des enquêtes, une troisième retombée est l'articulation de plus en plus intéressante entre les batteries de chiffres, les résultats de recherches sur le terrain en sciences sociales et l'expérience des acteurs - avec toutes les controverses salutaires que cela implique.
Prouver quoi ?
Mais alors, pour mieux connaître les problèmes de santé au travail dans une entreprise et agir dans ce domaine, suffit-il de " faire pareil " que dans ces dispositifs nationaux ? Nous aussi, dans cette usine, dans ces bureaux, ces magasins, il nous faut " notre " enquête. Là aussi, on a besoin de sensibiliser, de préciser les approches, de débattre. Là aussi, les sources statistiques usuelles (taux de fréquence et de gravité des accidents, nombre de maladies professionnelles reconnues) éclairent peu la compréhension. Là aussi, on peut réunir quelques bonnes volontés, quelques compétences et un logiciel de traitement statistique à peu près performant, pour produire des questionnaires, puis des tableaux et graphiques, afin de prouver... de prouver quoi, justement, et comment, pour qui, pour quoi faire ?
S'il s'agit de revérifier des résultats épidémiologiques bien connus, avec en outre la fragilité due à la taille modeste des échantillons, est-ce bien nécessaire ? Si la réalisation et l'exploitation d'une enquête amènent à différer d'un ou deux ans le lancement d'une action préventive dont tout le monde voit déjà le bien-fondé, n'est-ce pas contre-productif ? Si les résultats, fragiles techniquement, semblent indiquer qu'il n'y aurait " pas trop de problèmes " alors que les acteurs en santé au travail ont de bonnes raisons de penser le contraire, n'est-ce pas démobilisateur ? Si, enfin, on prend l'habitude d'attendre les chiffres pour savoir " la vérité ", ne discrédite-t-on pas les connaissances assemblées par les praticiens, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les salariés eux-mêmes ?
Il arrive qu'une telle opération ait du sens, mais alors sa préparation collective " près du terrain ", la confrontation de points de vue tout au long de la démarche, la prise qu'offre l'enquête à des questionnements de nature différente ont au moins autant d'importance que la rigueur technique dans la production des chiffres. On comprend donc que les questions de légitimité, de faisabilité et de retombées d'une opération statistique en santé au travail ne se posent pas dans les mêmes termes d'une entreprise à l'autre et ne se résolvent pas par imitation de dispositifs nationaux.
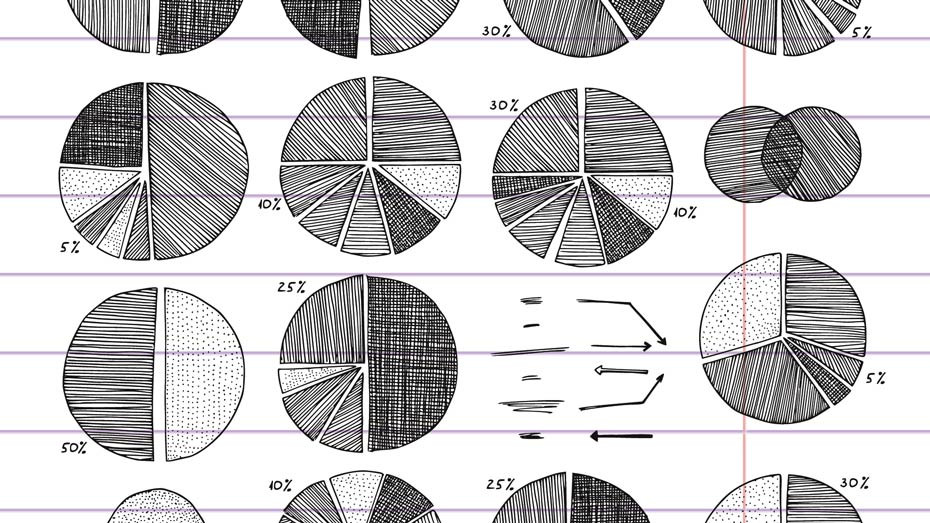 © Shutterstockl
© Shutterstockl