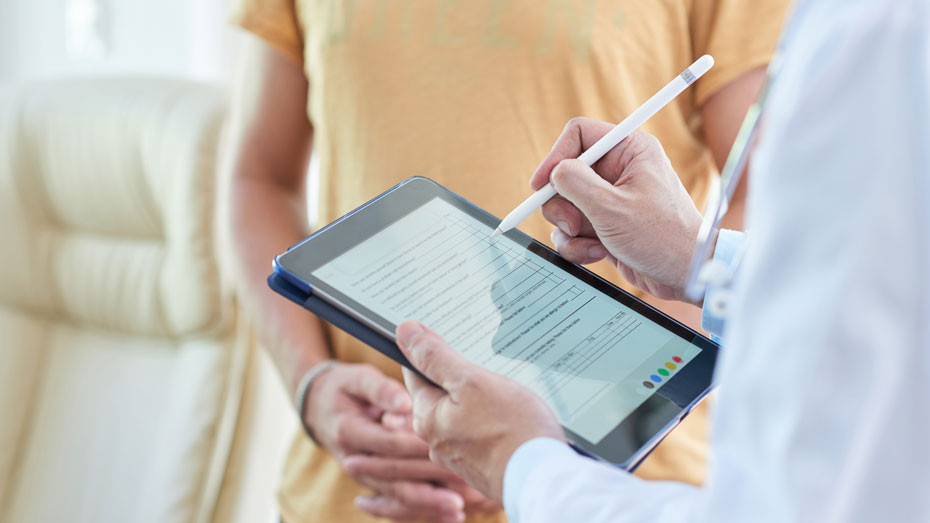
L’enquête Sumer fait peau neuve pour s’adapter aux évolutions de la médecine du travail
Confronté à une baisse drastique du nombre de médecins du travail volontaires pour remplir le questionnaire Sumer, le comité scientifique de l’enquête a décidé d’en changer la périodicité.
C’est l’une des bases statistiques les plus utilisées pour repérer et mesurer les expositions aux risques professionnels des salariés. Et le questionnaire phare de la médecine du travail. L’enquête Sumer (pour Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels) va connaître une importante refonte lors de ses futures éditions.
Produite par la direction de l'Animation de la recherche, des Etudes et des Statistiques (Dares) en collaboration avec l’inspection médicale du travail (IMT), l’enquête Sumer se démarque par son protocole : ce sont des médecins du travail, et non des statisticiens, qui recueillent les données. Ces médecins, volontaires, mènent des entretiens poussés auprès de salariés tirés au sort et complètent un questionnaire sur les risques physiques, biologiques, chimiques et organisationnels, auxquels ils sont exposés. « Les médecins découvrent avec cette enquête des expositions qu'ils n'auraient pas imaginées. », décrit Nicolas Sandret, ancien médecin inspecteur du travail et membre du comité scientifique de l’enquête Sumer.
Raréfaction des médecins volontaires
Mais alors que 2 400 médecins s’étaient portés volontaires en 2010, seuls 1 200 ont répondu à l’appel pour l’édition suivante, en 2017. Autrement dit, moitié moins. Cette désaffection s’explique par les réformes successives qui ont bouleversé les organisations du travail des médecins mais aussi par la pénurie de praticiens. Entre 2010 et 2018, le nombre de médecins du travail sur le territoire français a chuté de 5 600 à 4 700, ce qui correspond à une baisse de 20% des effectifs. « Les médecins du travail se sont retrouvés surchargés. Alors beaucoup se sont désengagés de l’enquête, ou ont abandonné en cours de route », observe Nicolas Sandret. Et qui dit moins de médecins-enquêteurs dit moins de salariés enquêtés, et in fine, des données statistiques moins solides.
Le comité scientifique de Sumer a proposé une refonte de l’enquête pour résoudre ce problème. A partir de la prochaine édition au deuxième semestre 2026, l'enquête sera reconduite chaque année, et non plus tous les sept ans. Les médecins volontaires rempliront dix questionnaires par an au lieu de 30 par trimestre auparavant.
« On s’est dit qu’on allait demander moins de questionnaires d’un coup et sur une période plus longue, afin de lisser la charge de travail », explique Marion Duval, chargée de l’enquête Sumer à la Dares. En effet, remplir le questionnaire est chronophage : entre 45 minutes et une heure, ce qui demande aux praticiens de bloquer plusieurs créneaux de rendez-vous.
Instaurer une routine Sumer
L’annualisation pourrait aussi fidéliser les volontaires, qui n’auront plus à se refaire la main tous les sept ans. Ils seront en revanche formés tous les cinq ans. Et le personnel soignant des services de santé au travail, notamment les infirmiers et infirmières dont les compétences se sont élargies depuis la loi de 2021, devraient aussi être davantage intégrés au travail d'enquête. « L'enquête va rentrer dans la routine des services de prévention et de santé au travail », prévoit Marion Duval.
La nouvelle périodicité de Sumer ne devrait pas impacter ses résultats. Afin de garantir la comparabilité des données, la grille du questionnaire reste identique, si l’on excepte quelques ajouts sur la soutenabilité du travail, la gêne occasionnée par les vagues de chaleur ou de froid, le flex office, le fait de travailler en étant malade, etc.
Finalement, une base de données équivalente à celle de 2017 devrait être reconstituée d’ici trois ou quatre ans. « Et en attendant encore un peu, on espère augmenter le nombre de résultats, et avoir plus de précisions et de détails que précédemment », assure Elisabeth Algava, cheffe du département Conditions de travail et santé à la Dares.
Cette refonte de Sumer doit aussi conforter sa légitimité scientifique et institutionnelle. A ses débuts en 1994, l’enquête était régulièrement critiquée par le patronat, qui prétendait que les médecins volontaires surestimaient les expositions aux risques des salariés. « La dernière attaque a été très violente : en 2007, le Medef a écrit au ministre du Travail pour arrêter Sumer », se souvient Nicolas Sandret, précisant qu'à présent, « le patronat participe avec les représentants des salariés à l'élaboration de cette enquête ».
« Le ministère tient beaucoup à l’enquête »
L’enquête Sumer s’est institutionnalisée dans le courant des années 2000. En 2010, elle a été reconnue d’intérêt général par le Conseil national de l’information statistique (Cnis), qui l’a labellisée pour sa qualité et sa représentativité statistiques.
« Le ministère [du Travail] tient beaucoup à l'enquête : c'est le seul outil qui donne un repérage aussi précis des expositions chimiques, avec le ressenti des salariés, poursuit Nicolas Sandret. Ainsi, elle permet de réfléchir aux politiques de prévention. » Les résultats de l’enquête Sumer sont repris par le Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) pour élaborer les orientations qui inspirent les plans santé au travail. Et ils servent aussi à identifier les facteurs de pénibilité auxquels sont exposés les salariés concernés par le compte professionnel de prévention (C2P).
Plusieurs fois, par le passé, l’idée de rendre l’enquête Sumer obligatoire pour les médecins du travail a été évoquée. Mais cela reste pour le moment « totalement exclu » pour la Dares, même si le nombre de volontaires s'amenuise. « Si la mission de veille sanitaire est obligatoire pour les services de prévention et de santé au travail, il existe différents dispositifs et manières de la réaliser. Les médecins doivent pouvoir choisir, expose Marion Duval. Nous ne sommes pas persuadés que rendre l’enquête Sumer obligatoire soit pertinent. »
« Pour une pratique de la médecine du travail au plus près des salariés », entretien avec Alain Carré, médecin du travail, par Nolwenn Weiler, Santé & travail, mars 2025.
La médecine du travail à la peine sur la prévention, par Joëlle Maraschin, Santé & travail, mars 2024.
La médecine du travail à tâtons sur la désinsertion, par Catherine Abou El Khair, Santé & travail, septembre 2023.