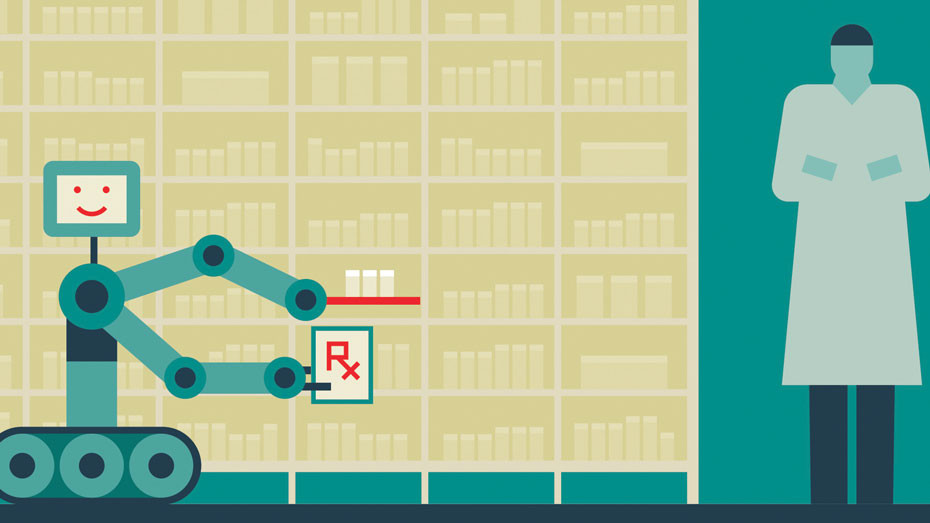C’était le monde d’avant la robotisation des pharmacies hospitalières. Le préparateur analysait dans leur ensemble les prescriptions de médicaments délivrés aux malades et veillait à leur validité : indications, posologies, effets indésirables, interactions médicamenteuses, surdosages, etc. Il donnait des conseils de bon usage aux soignants, voire aux patients, et pouvait consulter le pharmacien en cas de doute. Aujourd’hui, dans un hôpital parisien dont la pharmacie intérieure a été automatisée, le travail est différent : les préparateurs ont une liste de boîtes de médicaments à fournir à chaque service de l’établissement, la prescription ayant été validée informatiquement par les pharmaciens.
Entre ces deux périodes, le métier a dû faire face à plusieurs bouleversements : scandale du sang contaminé, nouvelles pratiques gestionnaires à l’hôpital, exigences accrues de performance. En 2005, la réforme du système de santé a ainsi introduit le contrat de bon usage des médicaments, visant à instaurer une traçabilité systématique sur l’ensemble du circuit. La tarification à l’activité (T2A), en poussant à la rotation des malades occupant les lits, a conduit à une augmentation de la demande médicamenteuse. Pour faire face à ces contraintes de sécurité, d’économies et d’intensification du travail, une réponse technologique a été trouvée : l’automatisation des pharmacies hospitalières.
« On n’était pas de simples exécutants »
Concrètement, le stockage des médicaments se fait dans un entrepôt logistique, en zone industrielle, parfois loin des établissements de soin. Au sein même de l’hôpital, leur transport s’effectue par différents moyens : petits trains, navettes, tortues ou encore, en fonction de la taille, cartouches pneumatiques. Enfin, dans les gros centres hospitaliers, ce sont des automates qui constituent les piluliers individuels, y compris pour les chimiothérapies. Pour les préparateurs en pharmacie, la transition ne se fait pas sans mal : « Il y a beaucoup de choses qu’on perd, beaucoup d’acquis et de réflexes qu’on avait à une époque et qu’on n’a plus maintenant. On n’était pas de simples exécutants et il fallait absolument réfléchir à tout ce qu’on faisait », regrette Fanny, qui fait ce métier depuis treize ans. C’est un des témoignages recueillis par Caroline Labarthe, cadre de santé à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), dans son mémoire sur l’automatisation des pharmacies intérieures des hôpitaux
.
Ses observations montrent pourtant que l’utilisation de robots libère du temps et décharge de certaines tâches de manutention, ce qui pourrait permettre aux professionnels de développer d’autres activités. Mais les conditions sont loin d’être réunies pour que cette montée en compétences puisse se réaliser. Ainsi, dans un centre hospitalier du Sud-Ouest, le taux d’absentéisme au sein de la pharmacie croît constamment. Laetitia
, cadre de santé, y voit une conséquence de la transformation du métier provoquée par l’automatisation : celle-ci segmente l’activité et isole les préparateurs, qui perdent le lien avec les services et ne suivent plus l’évolution de l’état des patients. Elle note toutefois une exception à cet absentéisme dans l’entité de préparation des chimiothérapies, parce qu’ils « trouvent l’activité valorisante et y sont plus proches des patients ». Laetitia veille d’ailleurs à ce que « toutes les semaines, le préparateur aille dans les services scanner les étiquettes alors que celles-ci pourraient être envoyées par pneumatique ». Car, à ses yeux, « il est important que ce professionnel fasse partie du soin et joue son rôle éducatif en se rendant sur place ».
Dans un autre établissement de la région, la production des poches de nutrition par voie veineuse a elle aussi été robotisée. Désormais, après que le pharmacien a validé la prescription, la poche est remplie par deux préparateurs assistés d’une machine. « Auparavant, l’opération se déroulait alors qu’ils étaient équipés d’un scaphandre, avec toutes les contraintes inhérentes, explique Valérie, cadre de santé de la pharmacie. Cela nous a permis de sécuriser l’activité, d’augmenter la production, de réduire le stress et les troubles musculosquelettiques. » Mais le robot peut connaître des pannes, ce qui contraint les préparateurs à se relayer pour mener à bien le travail prévu. « Si toute l’activité était automatisée, nous ne pourrions pas le faire », reconnaît Valérie. Avec cette nouvelle technologie, le risque est aussi de remplacer une pénibilité par une autre car c’est la machine qui « dicte le rythme ».
Un vécu différent
Caroline Labarthe constate que « les équipes ne vivent pas l’automatisation de la même manière », selon les choix effectués par les responsables. Pour son mémoire, elle a ainsi observé deux approches de réorganisation à l’occasion de la robotisation : « Dans le premier cas, le but était de réduire les effectifs et de gagner sur le plan financier, relate-t-elle. Dans le second, il était question de monter en compétences et de développer les technologies. Dans ce cadre, les personnels ont été consultés, ils ont pu apporter des informations cruciales. Personne n’a découvert au moment de leur mise en place comment les robots marchaient. Ça s’est beaucoup mieux passé. »
Lorsque les projets sont ainsi réfléchis, il est possible que « les automates libèrent du temps pour des activités plus valorisantes, comme la conciliation médicamenteuse », veut croire Laetitia, qui détaille ce travail : « Le préparateur doit recueillir la liste complète de tous les traitements médicamenteux, qui est ensuite soumise à la validation pharmaceutique pour prévenir et intercepter les erreurs. »
Mais le choix de la technologie comme celui de la réorganisation qui accompagne son installation sont rarement discutés avec les équipes. Malheureusement pour les préparateurs concernés.
 © Luc Melanson
© Luc Melanson