Les intelligences artificielles conversationnelles, informationnelles et bientôt agissantes, bouleversent fondamentalement les personnes, les cadres et les conditions de travail. Au-delà de l’introduction d’un système de surveillance, d’un algorithme d’aide à la rédaction de courriels, d’un instrument de partage des informations ou d’un appareillage de très haute précision, l’IA est porteuse d’un changement d’échelle rarement observé auparavant.
En présence d’un tel mouvement affectant directement les organisations du travail, les questionnements juridiques sont nombreux, qu’il s’agisse des données personnelles, de la responsabilité des acteurs, de l’implication des représentants du personnel ou de la santé et de la sécurité au travail. Pour autant, comme à tout moment charnière, la force du droit est là. La loi n’a pas pour ambition et raison d’être de traiter de cas particuliers, mais de fixer des règles de portée générale, ayant vocation à s’appliquer à tous et en toutes circonstances.
En tranchant les contentieux, la jurisprudence contribue aussi à poser les principes susceptibles de s’appliquer au-delà des seuls cas d’espèce. Il n’est par conséquent pas nécessairement besoin d’un droit nouveau pour envisager la régulation de l’usage des IA en santé-travail. Le droit de la santé au travail est loin d’être démuni, même si des adaptations peuvent être nécessaires.
Les outils du droit positif
En droit positif, les normes européennes et internes s’imposent. Le règlement européen sur l’IA oblige à la transparence, interdit le repérage des émotions ou le classement des personnes sur des critères biométriques. Le Règlement général de protection des données (RGPD) implique que les salariés soient informés de tout recours à un traitement de données à caractère personnel les concernant.
Pareillement, les principes juridiques de responsabilité demeurent. En la matière, il est d’abord attendu de l’employeur qu’il garantisse la santé et la sécurité des personnes au travail, ce qui implique « la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés » et l’« adaptation des mesures », en tenant compte « du changement des circonstances » (article L. 4121-1 C. trav.).
Conformément à cette finalité, les neuf principes généraux de prévention fixent les lignes directrices de l’action patronale : combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, tenir compte de l’état d’évolution de la technique ou par exemple, donner les instructions appropriées (art. L. 4121-2 C. trav.). Et concrètement, le document unique d'évaluation des risques professionnels (Duerp) et le Programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (Papripact) doivent bien évidemment intégrer l’IA, en tant que déterminant de l’organisation du travail. A défaut, le juge ne pourra que constater que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, en ayant été insuffisamment préventif.
Consultation, expertise, droit d’alerte…
Dans le même sens, les prérogatives des représentants du personnel demeurent complètement opérantes avec l’IA : information sur les outils déployés (dans le cadre des consultations, lors de l’introduction de nouvelles technologies, si un aménagement important modifie les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ou via la Base de données économiques, sociales et environnementales, par exemple), recours à un expert ou activation éventuelle du droit d’alerte.
De la même manière, lorsque la négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail porte sur la régulation de l’usage des outils numériques, cela inclut l’IA. Si la règle de droit n’est pas nécessairement immuable, elle est susceptible, du fait de sa généralité, de s’adapter à toute mutation : en présence des IA, les fondamentaux du droit de la santé au travail demeurent et l’impératif de sécurité dans le travail reste intangible.
L'intégralité de notre dossier n°129 à télécharger :
Dossier Santé & Travail IA_0.pdf
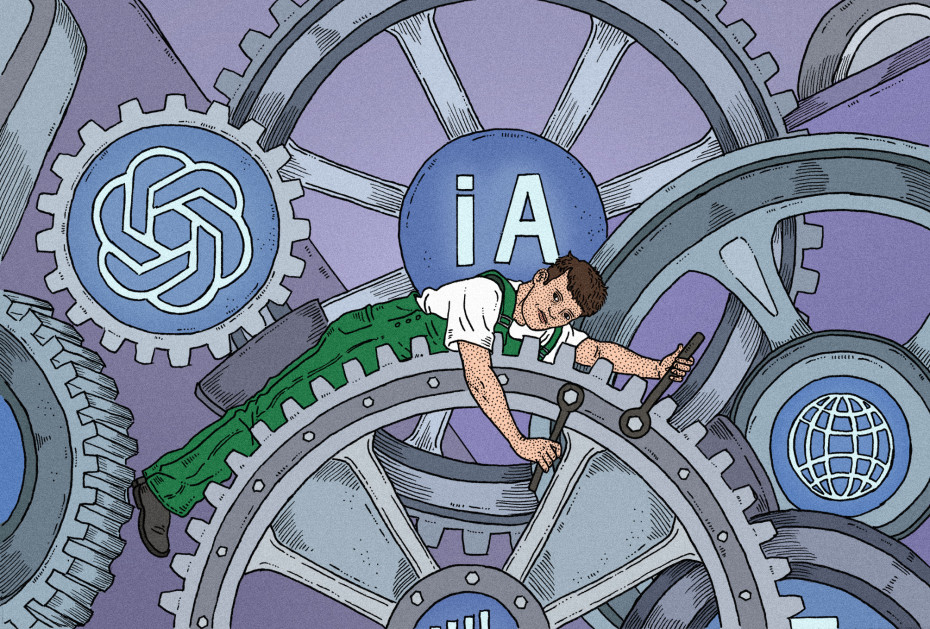 © Candice Roger
© Candice Roger
