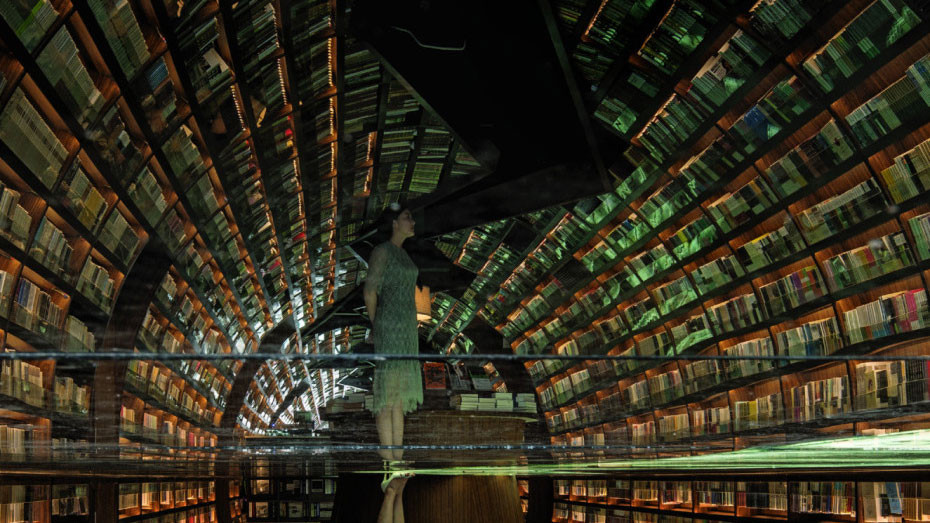Qu’est-ce qui différentie l’IA des précédentes révolutions informatiques dans le travail ?
Mathieu Corteel : Avec l’IA, on touche au processus même du travail, c'est-à-dire à l'activité cognitive, aussi bien individuelle que collective, au sein des organisations. On empiète sur la capacité d'inventer collectivement, de créer, de faire des projets, d'interagir. Un lien de continuité psychologique se noue avec ces technologies, qui touche au langage, à la représentation de soi et des autres, et cette hybridation humain-machine produit un impact bien plus important que celui d'autres technologies. C'est une rupture organisationnelle voire anthropologique.
Avec le déploiement de l’IA, on aboutit selon vous à un nouveau système d'exploitation des travailleurs ?
M.C. : Avec le développement des technologies d'information et de communication nous sommes entrés dans l’ère du capitalisme cognitif, celui qui crée une hégémonie des immatériels dans l'économie. Une partie de ces immatériels est protégée par le droit d’auteur : livre, œuvre d’art, scénario, brevet d'innovation technologique. L’autre échappe au droit, il s’agit de l’ensemble des activités cognitives que nous faisons tous en ligne : écrire des mails, cliquer, commenter, liker, produire du contenu, en partager… Celle-là est captée par les géants du numérique : ils ont réussi à en avoir la propriété, l’exclusivité, et ainsi, à obtenir des places dominantes sur ce marché sans la moindre régulation.
Un processus d'expropriation de l'intelligence collective qui est la première phase du capitalisme cognitif. La deuxième, c’est l’exploitation de l'intelligence collective, à partir de ces collectes de données, de connaissances, etc. On entraîne, on perfectionne des algorithmes, dans le but de développer des machines qui ont vocation à effectuer non pas les tâches les plus rébarbatives, mais au contraire une partie des plus émancipatrices, c'est-à-dire les tâches créatives, celles qui procurent du sens à l'activité. C’est un nouveau système d'exploitation par la dévaluation de l'activité cognitive humaine la plus précieuse, et la plus émancipatrice. C’est par exemple, la crainte des scénaristes d'Hollywood qui ont fait grève en 2023.
L’exploitation, n’est-ce pas aussi celle des millions de travailleurs du clic, annotateurs de données, et autres modérateurs de contenus que nécessitent les IA ?
M.C. : Oui, une exploitation, et parfois une maltraitance extrêmement poussée. Je pense au micro-travail de ceux qui doivent faire des captures d’images pour dresser les IA, pour améliorer les systèmes de reconnaissance de réseaux de neurones, à ces quelque 200 modérateurs qui ont déposé une demande d'indemnisation auprès des tribunaux kenyans, parce qu’ils souffrent d’un syndrome de stress post-traumatique du fait de leurs conditions de travail : chaque jour, durant des heures, ils sont exposés à des images dérangeantes ou violentes, afin de nourrir l’intelligence artificielle qui prendra peut-être un jour leur place.
Vous ne rejetez pas pour autant l’IA au travail ?
M. C. : Les IA peuvent être des outils fantastiques, si on ne tombe pas dans le piège de la déification. Elles peuvent amener à des pratiques du travail améliorées, si elles répondent à des besoins réels et concrets. Mais aujourd’hui on met la charrue avant les bœufs : on pense qu’il faut innover à tout prix, mettre des IA partout, et voir ensuite ce qui marche, dans une dynamique de croissance. Or on n'a pas fait de travail d’évaluation au préalable, pour savoir si ces outils répondent à des besoins précis dans les organisations, ni, non plus, pour mesurer les effets de leur déploiement sur les travailleurs.
Nous sommes entrés dans un laboratoire avec des outils qui produisent des contenus pouvant dépasser la production humaine sans aucune idée de ce que peuvent engendrer ces contenus ni de leur impact psychosocial sur les utilisateurs. Avant d’implémenter l'IA partout, il serait bon, au contraire, de faire des évaluations, de mettre en œuvre les outils des sciences sociales pour déterminer les besoins et les risques, car c’est un enjeu majeur de transformation.
Quels effets craignez-vous sur la santé des travailleurs ?
M. C. : L’hybridation avec l'IA peut créer des espaces de non-sens qui amènent à des injonctions contradictoires, et à mon sens, peuvent générer de la folie. Pour le travailleur, n'être qu'un vecteur d'information, avec une technologie destinée à accélérer les cadences, à travailler plus vite, sans aucun processus de co-construction collective du travail, est un agencement aliénant, avec une perte du sens de l’activité. Nous jouons aux apprentis sorciers avec ces technologies, alors que nous n’avons pas développé la culture critique nécessaire.
« Parler avec une IA, c'est comme parler avec un psychopathe, écrivez-vous, dont la conversation peut nous entraîner vers le pire. » Pourquoi ?
M. C. : Derrière l’IA, il n'y a rien d’autre qu'un calcul mathématique très sophistiqué : il n’y a aucune intériorité, aucun sentiment, aucune compassion, et pourtant, on a l'illusion que si. Comme avec les psychopathes, qui arrivent à feinter, simuler des émotions alors qu’ils ne ressentent rien. Les IA sont amorales, ce sont des rationalités instrumentales, et des programmes qui peuvent être influencés d’une manière ou d'une autre. Or, on voit bien que les forces actives sur les réseaux sociaux, celles qui nourrissent ces technologies, promeuvent des tendances extrêmement réactionnaires.
Les IA donnent une impression de neutralité mais sont aujourd'hui entre les mains de puissances à l’idéologie libertarienne de droite. Un dogme nauséabond et dangereux qui doit être combattu. On n'a pas mesuré tout le potentiel d’influence des IA, capables de modifier et déstabiliser le jugement humain. Je pense que les solutions viendront de la capacité qu'on aura tous ensemble de redéfinir la répartition des compétences entre humain et machine, la part d’intelligence collective d'une organisation qu'on peut déléguer à des IA, et celle qui relève du « cœur de métier », qu'il faut au contraire réévaluer et valoriser absolument.
L'intégralité de notre dossier n°129 à télécharger :
Dossier Santé & Travail IA.pdf
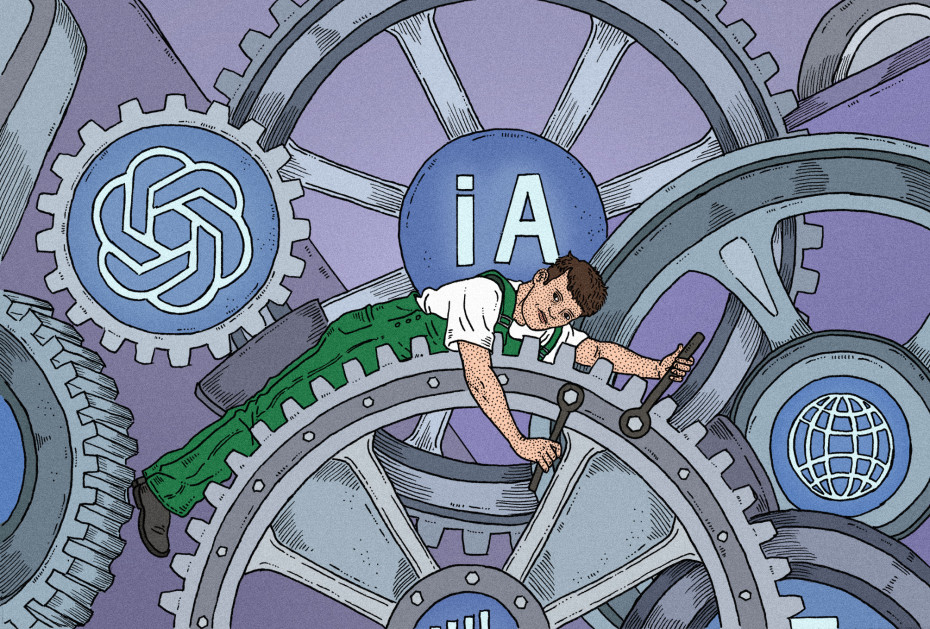 © Candice Roger
© Candice Roger