Jugés trop nombreux, les arrêts maladie sont toujours dans le collimateur des politiques publiques, du fait notamment de la hausse des indemnités journalières (IJ) versées (+ 4,4 % en 2017). Leur diminution est considérée comme un levier de réduction des dépenses de santé, la chasse aux pratiques présumées "abusives" de gros prescripteurs étant un des moyens d'y parvenir. Une orientation qui met la pression sur les médecins généralistes.
Pourtant, comme l'indique le rapport rendu le 20 février par une mission sur les arrêts maladie mandatée par le gouvernement (voir l'interview page 40), l'un des principaux facteurs de la hausse des dépenses en IJ est "l'augmentation forte et rapide des taux d'activité aux âges élevés", consécutive en particulier au recul de l'âge de la retraite. En outre, les arrêts les plus nombreux, à savoir les plus courts, ne constituent pas un enjeu réel en termes de dépenses. En 2017, ceux de moins de sept jours représentaient 44 % du nombre total d'arrêts, mais seulement 4 % de la dépense indemnisée. Tandis que les arrêts de plus de six mois, ne comptant que pour 7 % du total, pesaient pour 44 % de la dépense.
Des normes contestées
"En se focalisant sur les IJ et sur les prescriptions, on se trompe de sujet, affirme Jacques Battistoni, président du syndicat de généralistes MG France. Sur les arrêts courts, on fait des économies de bouts de chandelle ; sur les longs, l'enjeu principal est de prévenir la désinsertion professionnelle, ce qui ne repose pas que sur le généraliste. Ce n'est pas une solution de chercher à faire baisser les chiffres par la contrainte." Une contrainte qui s'appuie sur des indicateurs peu probants pour les généralistes, car très éloignés, à leurs yeux, de la réalité de leurs conditions d'exercice.
Pilotée nationalement, la mission de contrôle de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) s'appuie sur un algorithme qui mouline les données des déclarations d'arrêts de travail et déclenche une procédure dite "d'accompagnement". "Le contrôle en lui-même n'est pas adapté, indique Florence Lapica, déléguée Rhône-Alpes de MG France. Il n'individualise pas et met en regard les prescriptions de jours d'arrêt que chaque médecin totalise avec une moyenne territoriale, dont rien ne dit par ailleurs qu'elle est la "normale"." Il suffit d'avoir quelques patients en affection de longue durée (ALD), ou une surcharge de travail liée à un manque ponctuel de médecins, pour plomber ses statistiques. La Cnam se réfère aussi à des normes de durée optimale d'arrêt de travail en fonction des affections : trois jours pour un mal de dos, par exemple.
"Ces indicateurs servent de base de discussion lors des contrôles, explique Stéphane Malefond, vice-président du Syndicat autonome des praticiens-conseils (SAPC-Unsa). Mais avec la mise en place de ces outils, il y a deux-trois ans, le rôle de contrôle individuel du médecin-conseil s'est appauvri ; il a moins de latitude." La déclaration en ligne des arrêts de travail - fortement conseillée et appelée à se généraliser - donne également une durée en fonction de la pathologie.
Tous ces éléments ne sont pas neutres, car ils touchent à la pratique médicale. "L'arrêt de travail est un acte thérapeutique, rappelle Martine Lalande, vice-présidente du Syndicat de la médecine générale (SMG). Il dépend de l'activité des patients, de leurs conditions de travail, de leur environnement professionnel, de la façon dont ils le vivent. C'est notre quotidien de les écouter et de voir avec eux si l'arrêt est adapté. On ne peut pas "protocoliser" le rapport au travail des gens."
Le poids de l'environnement socioprofessionnel
On ne peut pas exclure non plus l'environnement dans lequel exerce le praticien. C'est ce que montre la recherche menée par deux sociologues, Jorge Muñoz et Gabrielle Lecomte-Ménahès (voir "A lire"), à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Finistère. En 2017, dans ce département, 11 IJ ont été versées en moyenne aux assurés âgés de 15 à 64 ans, contre 9,8 à l'échelon régional et 9,4 au national. L'étude met en évidence, à travers une analyse statistique des arrêts, qu'il existe une relation entre le niveau de prescription et le contexte local. "Les médecins qui prescrivent le plus et le plus longtemps sont essentiellement des hommes âgés exerçant seuls dans des zones rurales où l'offre médicale est limitée, exposent les chercheurs. Leur patientèle, masculine en majorité, souvent en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, travaille dans des secteurs où les conditions sont difficiles : construction, transport, agroalimentaire..."
Les sociologues ajoutent que, dans les entretiens réalisés avec ces praticiens et leurs patients, "la question du travail est omniprésente parce qu'il est souvent à l'origine de l'arrêt, parce qu'il est un facteur aggravant de l'état de santé, parce qu'il est déterminant dans la perspective du retour au poste...". Entre la gestion de patients en difficulté et le recours compliqué à des spécialistes peu présents, les médecins vont davantage prescrire d'arrêts, le temps d'affiner leur diagnostic, notamment lorsqu'ils sont confrontés à des troubles d'ordre psychosocial liés à des facteurs professionnels qu'ils ne maîtrisent pas.
Les généralistes, qui font un "diagnostic de situation", selon l'expression de Jean-Claude Soulary-Douai, vice-président de MG France, sont témoins des évolutions du monde du travail. "L'environnement professionnel est de plus en plus difficile, constate ce praticien, qui exerce à Dechy (Nord). Beaucoup de problèmes liés aux conditions de travail ou au mode de management retentissent sur l'état de santé. Mais la pression est plus forte aujourd'hui, car les gens ont peur de perdre leur emploi. D'ailleurs, ils refusent souvent de s'arrêter."
Confrontés à ces facteurs structurels, les professionnels de santé, par ailleurs très soucieux de leur indépendance, pointent l'aspect arbitraire du contrôle par le biais d'un indicateur chiffré. Les syndicats MG France et FMF dénoncent régulièrement un "harcèlement de la Sécu". Dans les Côtes-d'Armor, un collectif s'est récemment mobilisé pour protester contre la politique de contrôle de leur Cpam, et le "délit statistique" qu'elle instruit, après la multiplication des convocations de praticiens. Des actes qui ne sont pas anodins, car les médecins peuvent à terme subir des amendes ou une suspension de la part de cotisations sociales prise en charge par la Sécurité sociale. Ces sanctions semblent rares. Mais la Cnam n'a pas souhaité répondre à nos questions sur son dispositif de contrôle.
"Choquant, brutal"
Avant d'en arriver là, les praticiens sont tout d'abord contactés par leur Cpam, afin d'attirer leur attention sur leurs écarts à la moyenne, ou bien ils reçoivent un courrier assorti d'une exigence de baisse. "C'est choquant, brutal, accusateur", juge Jean-Claude Soulary-Douai. Quand le médecin est convoqué, "on entre un peu plus dans le détail statistique, on distingue les arrêts courts et longs... La discussion est plus simple. Mais ce n'est pas très utile et reste très mal vécu", poursuit le syndicaliste. Suivent éventuellement des mesures administratives. Dans la mise sous accord préalable, chaque prescription doit être validée en amont par le médecin-conseil. La mise sous objectif impose un chiffre de baisse des prescriptions sur une durée définie.
Il n'y a alors guère de marges, à part bricoler un peu sur les arrêts courts. "Mais sur quels critères ? Parce que j'ai peur et que je suis surveillée ?, s'insurge Florence Lapica. Et sur les arrêts longs, il faudrait quasiment sélectionner ses patients ! On n'est plus soignant." De fait, les praticiens vont bien souvent tenir les objectifs, au prix d'une modification de leur comportement et d'un certain découragement. Pour Martine Lalande, "le système de prime à la performance, sorte de treizième mois accordé selon des critères de l'Assurance maladie, contribue à les maintenir dans les clous".
En dépit d'un pilotage national, les pratiques varient d'une caisse à l'autre. En fonction de leurs objectifs, de leurs moyens, de leur direction... Elles sont néanmoins "évaluées selon leurs performances par rapport à la politique nationale, avec un système de récompense, notamment en termes de ressources humaines et de primes", signale Jorge Muñoz. Un schéma qui peut avoir des conséquences sur le quotidien des médecins-conseils. Certes isolé, le cas de ce praticien de Narbonne, victime d'une dépression reconnue en maladie professionnelle et qui a fait condamner la Cnam en 2016 pour harcèlement, met au jour des méthodes particulières. Dans cette affaire, la "signature par lots" est en cause. Celle-ci revient à faire accepter ou rejeter par le médecin-conseil tous les arrêts pour une pathologie, sans examen au cas par cas. Une pratique "incompatible avec le code de déontologie médicale", selon Me Cyril Cambon, avocat du praticien. "Sa résistance impactant ses objectifs de rendement, le médecin a fait l'objet d'une pression très importante et d'une discrimination", relate-t-il.
Sortir de l'impasse
"Ce cas n'est pas représentatif de ce qui se passe, estime Stéphane Malefond. Il y a certes par endroits des pressions spécifiques, mais ce n'est pas le système qui pousse au harcèlement." Et le médecin-conseil de préciser : "La vraie question est d'éviter qu'à force de maintien en arrêt de travail, la personne - ou le généraliste - ne se retrouve dans une impasse et, au contraire, de l'en faire sortir dans les meilleures conditions : aménagement de poste, temps partiel, reclassement, reconversion..." Une démarche qui exige une coopération entre le généraliste, le médecin du travail et le médecin-conseil. Pas si simple. Les relations des généralistes avec les médecins du travail sont variables, plus ou moins méfiantes. Quant à celles avec les médecins-conseils, le contexte évoqué précédemment n'arrange rien.
"C'est le rôle du médecin du travail d'interagir pour que l'arrêt soit le plus adapté à la situation et que le retour se fasse le mieux possible", relève Mélissa Menetrier, médecin du travail (et membre du comité de rédaction de Santé & Travail). Encore faut-il qu'il soit au courant de l'arrêt maladie du salarié et qu'il puisse le voir en visite de préreprise, comme le prévoit le cadre réglementaire. Cette visite, essentielle pour définir au plus tôt les aménagements nécessaires, peut être déclenchée à la demande du salarié, du généraliste ou du médecin-conseil. Or peu de praticiens font le relais. "Par manque d'information, de formation, les généralistes se sentent souvent désarmés, observent Jorge Muñoz et Gabrielle Lecomte-Ménahès. Ils soulignent leurs lacunes dans le médico-légal." La nécessité d'une meilleure transmission d'informations entre les praticiens et d'une réduction du délai pour la visite de préreprise a été pointée par la mission sur les arrêts maladie. Des questions qui devraient être abordées lors de la réforme à venir sur la santé au travail.
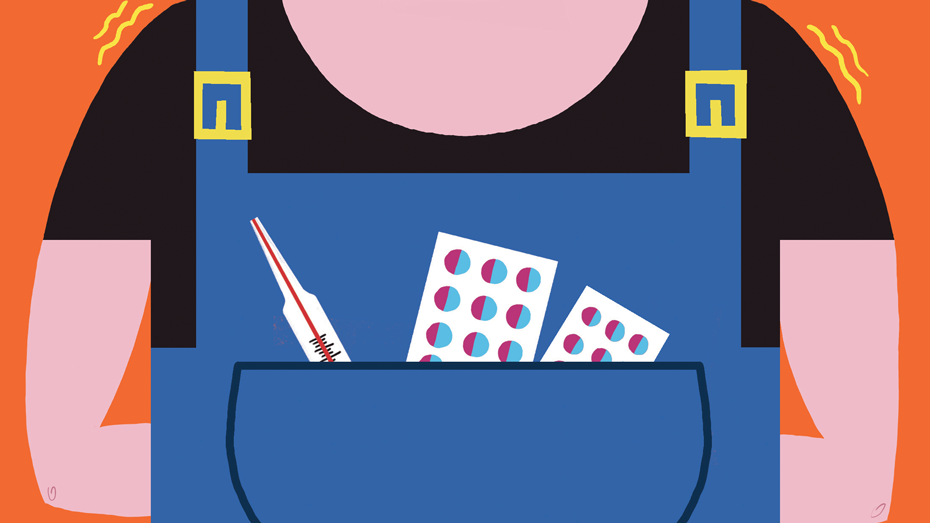 © Jérémie Clayes
© Jérémie Clayes
