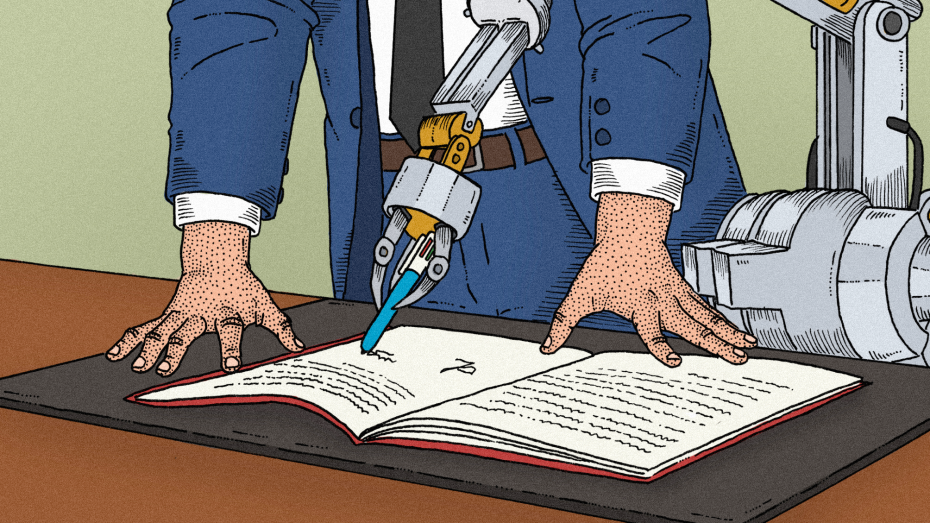Entre 2017 et 2024, en France, un peu moins d’un accord d’entreprise sur mille fait référence à l’intelligence artificielle. Ce constat du Centre de l’étude de l’emploi et du travail (CEET) du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) peut surprendre au regard de l’importante médiatisation de l’IA, mais il n’étonne pas Pierrette Howayeck, docteure en sciences de gestion à l'IAE de Paris : « En 2019, quand j’ai commencé ma thèse sur l’apprentissage organisationnel des syndicats face à l’IA, j’ai constaté qu’il n’y avait pas de dialogue social sur ce thème. Les syndicats n’étaient pas consultés. Les employeurs, les consultants ou les vendeurs de logiciels se contentaient de vérifier que le RGPD (Règlement général sur la protection des données) était respecté et que le Comité social et économique, le CSE, avait été informé. »
Indispensable montée en compétence
« L’implantation de systèmes d’intelligence artificielle (SIA) passe beaucoup par l’expérimentation. Et les expérimentations ne font pas partie du dialogue social », regrette Nicolas Blanc, secrétaire national CFE-CGC en charge du numérique et expert dans le cadre du Partenariat mondial de l’IA, au sein du groupe « futur du travail ». Or poursuit-il, ce sujet « ne doit pas être confisqué par les experts, ne serait-ce que parce que les impacts sur l’emploi restent flous. L’implantation de l’IA soulève des questions politiques qui exigent une confrontation de points de vue. Il est essentiel et urgent de mobiliser le dialogue social et de faire monter les militants syndicaux en compétences sur ces questions. »
Mais comment ouvrir la « boîte noire » du système d’intelligence artificielle ? Première étape, selon Aida Ponce Del Castillo, chercheuse à l’Institut syndical européen : démystifier le sujet, car la multiplicité de ses domaines d’application donne à l’IA une réputation de complexité, parfois intimidante. « Cela éloigne les instances représentatives du personnel du sujet alors que tous les SIA peuvent se définir simplement par trois points essentiels : 1/ Une entrée de données (input) ; 2/ Un objet généré concret ou non ; 3/ Un résultat (output). »
Cette question de l’acculturation des syndicats fait partie des points centraux du projet « DIAL-IA » (Dialogue sur l’IA). Porté et coordonné par l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires) et co-financé par l’Agence nationale de l’amélioration des conditions de travail (Anact), DIAL-IA a réuni pendant dix-huit mois une cinquantaine de participants du monde syndical et patronal, des secteurs public et privé, accompagnés d'experts et de chercheurs. De multiples outils pratiques sont issus de leurs échanges, et notamment diverses fiches listant des questions très concrètes qui permettent de saisir des aspects techniques, par exemple l’ossature utilisée pour mettre en place l’IA : quel moteur doit être privilégié (ChatGPT, Llama,etc…) ? Quel « entrainement » a eu lieu avant que le SIA soit installé dans l’entreprise ? Sur quels jeux de données ? Quel sera le lieu de stockage des données ? Seront-elles la propriété de l’entreprise ?
Prendre en compte le travail réel
« Pour pouvoir réfléchir en amont, il faut obtenir (s’il existe) le cahier des charges donné au prestataire. Sinon obtenir le DOU (document of understanding) que ce dernier a rédigé, suite à ces discussions avec la direction concernée », conseille DIAL-IA. Les impacts sur l’organisation du travail et sur l’emploi sont une autre priorité, avec, par exemple, les effets attendus en termes de diminution ou de hausse de la charge de travail. Ou les conséquences de l’arrivée d’algorithmes sur l'autonomie. « L’approche par fiche-emploi permet de regarder finement la manière dont il est impacté. Il ne faut pas se contenter de ce qui est annoncé, sans analyse concrète », avertit Nicolas Blanc.
« La prise en considération du travail réel et de l’expertise des travailleurs pour analyser les situations et élaborer des stratégies communes est primordiale, insiste Jérôme Gautié, professeur d’économie à l’Université Paris-I-Panthéon-Sorbonne. Il est indispensable de demander à l’employeur les raisons pour lesquelles il veut mettre en place un SIA. Qu’est-ce qu’il en attend ? Est-ce qu’il a bien conscience de tous les effets potentiels ? Pour les travailleurs, mais aussi pour les finances de l’entreprise. »
La réticence au dialogue social, une spécificité nationale ?
Nolwenn
Weiler
La France est-elle en retard sur la pratique du dialogue social relatif au déploiement de l’IA ? Pour Jérôme Gautié, professeur d’économie à l’Université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, cela ne fait aucun doute. Plusieurs raisons l’expliquent. « Sur ces questions de changements technologiques, et même d’organisation du travail en général, nos syndicats ont moins d'expertise que leurs homologues d’Allemagne ou des pays nordiques, qui ont investi ces champs depuis longtemps. Ce sont des sujets moins faciles que les salaires, l'emploi ou la précarité. Par ailleurs, les confédérations syndicales sont beaucoup plus puissantes dans ces pays-là, et elles ont beaucoup plus de moyens. » Autre spécificité française : « Les réticences du patronat à discuter de l’organisation du travail et de tous les choix qui peuvent l’impacter, par exemple le développement d’un système d’IA. »
L’étude du Cnam qui s’intéresse aux accords négociés autour de l’IA confirme cette analyse : « C’est une négociation difficile dans les modèles d’organisation du travail dominants qui ne promeuvent pas suffisamment la participation des salariés. » Du côté du projet DIAL-IA, on constate que « le SIA est trop souvent imposé à marche forcée dans une logique descendante. » Depuis plusieurs années, les syndicats réclament « un accord interprofessionnel pour négocier dans un cadre sécurisant pour les salariés et pour les entreprises, rappelle Nicolas Blanc de la CFE-CGC. Malheureusement, les organisations d’employeurs ne voient pas les choses de la même façon. Dans son Tour de France de l’IA , le Medef n’a pas mentionné le dialogue social. Il ne l’a pas fait non plus lors du sommet de l’IA en février 2025, qui était chapeauté par l’Elysée. » Sollicité par les syndicats sur la nécessaire négociation d’un accord interprofessionnel, le gouvernement n’a pas donné suite.
« C’est une étape très importante du dialogue social que de s'interroger ensemble sur les raisons pour lesquelles on se lance, confirme Aida Ponce Del Castillo. Est-ce que ce SIA est nécessaire ? Existe-t-il une alternative, quand bien même elle serait plus chère ? Et quels seront les bénéfices ? Les entreprises et les travailleurs se précipitent trop souvent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. » Les impacts environnementaux des SIA, très énergivores et grands consommateurs d’eau, devraient également, selon cette chercheuse, faire l’objet d’une prise de conscience collective.
Clause de revoyure et suspensions
Surtout, chercheurs et syndicalistes insistent sur l’importance d’inscrire le dialogue sur l’IA dans la durée. Ils suggèrent la mise en place d’une clause de revoyure, permettant d’interroger régulièrement la pertinence du modèle mis en place. « Seul le dialogue social permet de réagir en cas de dérive, avance Nicolas Blanc. Soit pour suspendre, soit pour interrompre un projet. »
Quelques affaires d’ores et déjà arrivées en justice ont rappelé que l’étape du dialogue social n’est pas négociable. En février dernier, le tribunal judiciaire de Nanterre a sommé une entreprise de bloquer le déploiement d’un SIA car le CSE n’avait pas été consulté, en dépit de ses multiples demandes. Trois ans plus tôt, en avril 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise avait estimé que le CSE pouvait recourir à une expertise « sans qu'il soit nécessaire de démontrer au préalable l'existence de répercussions sur les conditions de travail des salariés ». Mobiliser le dialogue social en amont des projets permettrait de réduire ce type de contentieux.
L'intégralité de notre dossier n°129 à télécharger :
Dossier Santé & Travail IA_4.pdf
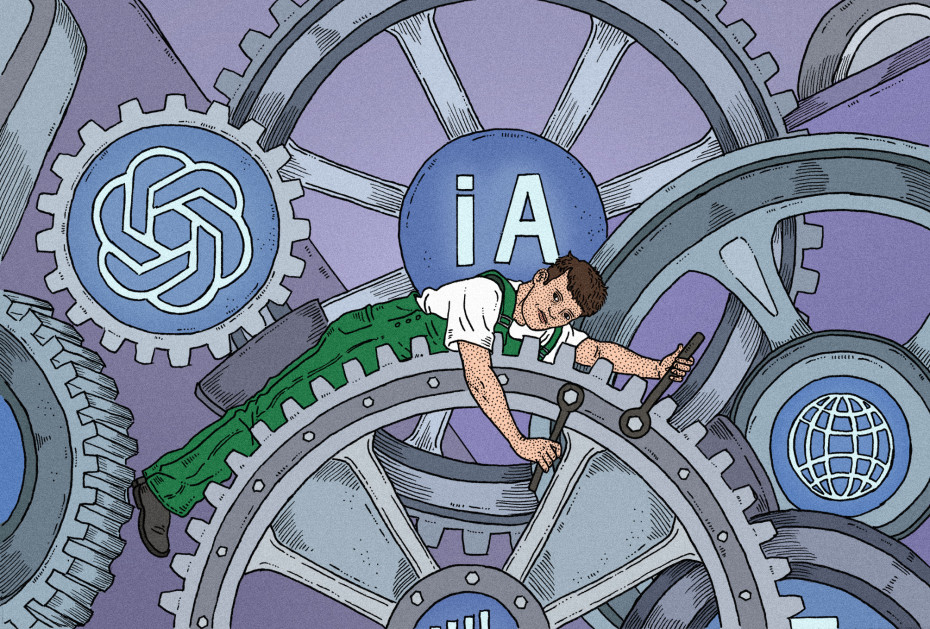 © Candice Roger
© Candice Roger